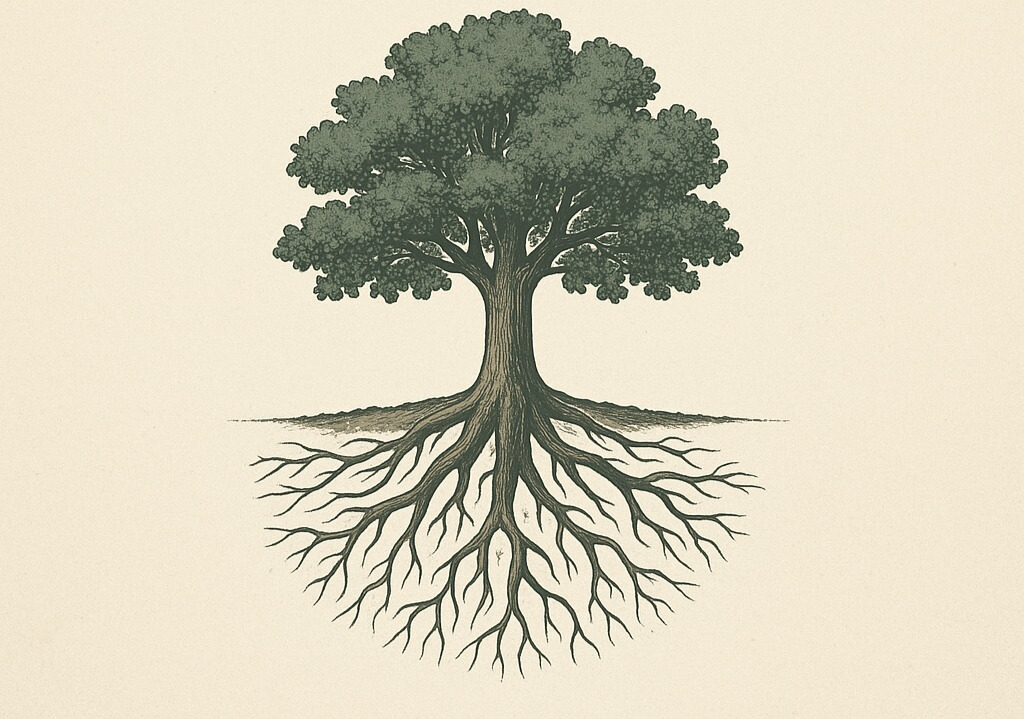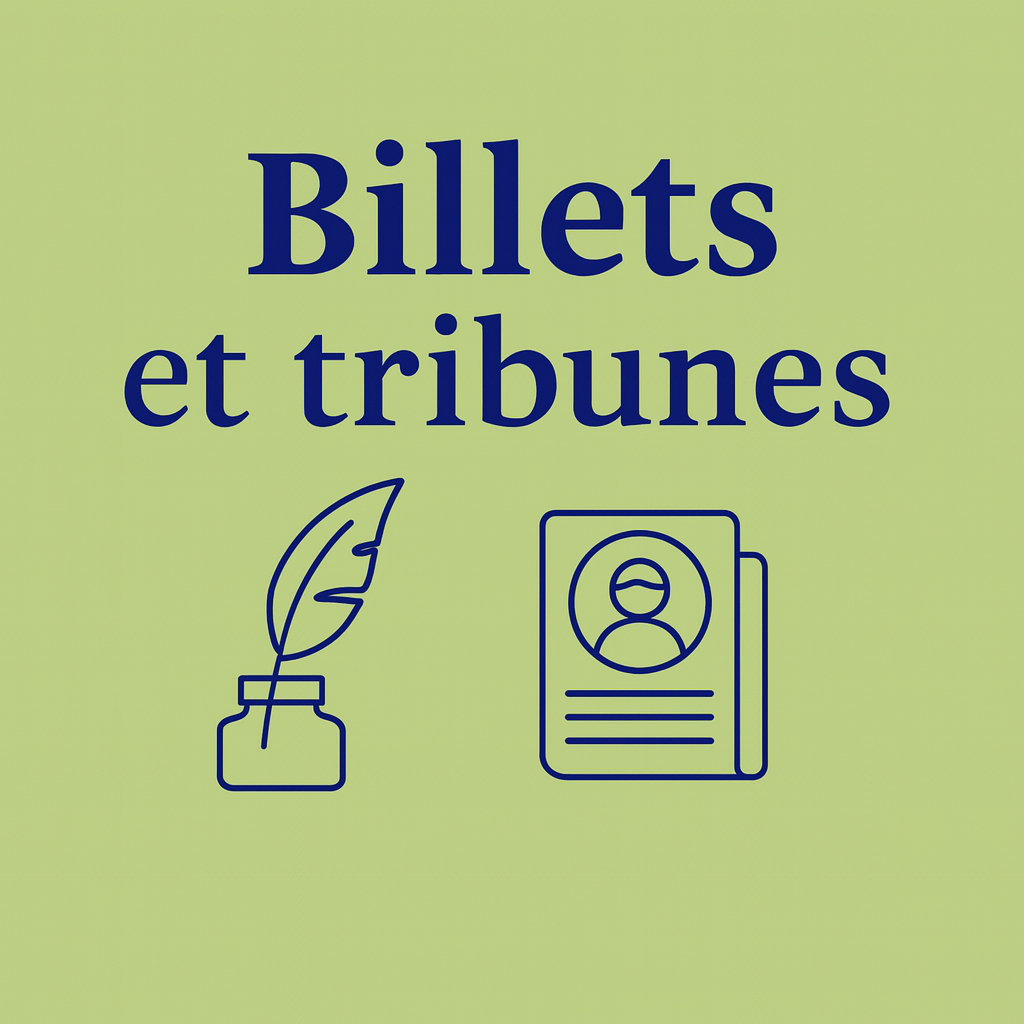par Jacques IGALENS, professeur émérite Université de TOULOUSE
Résumé
L’identité organisationnelle est un concept fondamental dans l’étude des entreprises, influençant leur stratégie, leur culture et leur pérennité. Cependant, les racines historiques et culturelles d’une organisation, bien que cruciales pour construire son identité, peuvent également constituer des pièges limitant son adaptation et son développement. Cet article explore les dynamiques entre la mémoire organisationnelle et les défis contemporains, en identifiant les risques liés à une rigidité identitaire excessive. Des pistes sont proposées pour concilier respect des racines et innovation organisationnelle.
Introduction
Qu’est-ce qu’une entreprise ? Tous les enseignants-chercheurs en sciences de gestion se sont posés la question. L’analyse économique définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Cette définition a notamment été reprise dans la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008. Bien que le droit français ne fournisse pas de définition universelle de l’entreprise (Despax, 1956)1, il reconnaît son importance et lui applique de nombreuses règles, adaptées selon le contexte et la branche du droit concernée (droit commercial, droit du travail, droit de la concurrence, etc.) Nous, enseignants-chercheurs en gestion, nous insistons sur la dimension humaine (ou sociale) des entreprises. Un programme de recherche en gestion définit ainsi l’entreprise comme « une communauté de sujets libres et responsables, parties prenantes à un projet qui a pour finalité la création d’un mieux. » (Beitone, & Hemdane, 2005)2. Un autre programme s’est proposé il y a quelques années de « refonder l’entreprise » (Hatchuel & Segrestin, 2012)3 et cette proposition a été partiellement retenue par le législateur en 2019 avec la création (par la loi PACTE) du statut des « entreprises à mission ». En 2025, on en compte environ 2000. La première condition pour devenir « société à mission » consiste à inscrire dans les statuts une « raison d’être » liée à l’activité de l’entreprise. Pour écrire et graver dans le marbre des statuts cette « raison d’être », les dirigeants ont été amenés à s’interroger sur leurs racines c’est à dire sur ce qui a jeté́ les bases de l’existence de leur entreprise. Souvent ils ont retenu le désir du (ou des) fondateur(s). Ce projet séminal correspond à une idée originale, parfois à des valeurs ; c’est toujours le produit d’un engagement qui a permis d’attirer les premiers actionnaires, les premiers collaborateurs, les premiers clients et les premiers fournisseurs. Qu’elle ait adopté le statut de « société à mission » ou non, l’entreprise se construit toujours sur un socle, sur des racines c’est-à-dire une intuition initiale accompagnée de valeurs, de convictions fondatrices qui forment ce qui deviendra l’héritage culturel (Albert et Whetten, 1985)4. Par la suite, ces éléments jouent un rôle clé dans la définition des objectifs stratégiques et dans la mobilisation des parties prenantes. Cependant,
1 Despax, M. L’entreprise et le droit, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1956
2 Beitone, A., & Hemdane, E. (2005). « La définition de l’entreprise dans les manuels de sciences économiques et sociales en classe de seconde ». Skholê, hors-série, 1, 29-39.
3 Hatchuel, A. & Segrestin, B. Refonder l’entreprise Paris, Ed Seuil. 2012
4 Albert, S., & Whetten, D. A. (1985). « Organizational identity ». Research in Organizational Behavior , 7(1), 263–295.
2
. Cette communication vise à analyser les bénéfices et les limites des racines organisationnelles en mettant en lumière les pièges potentiels d’une identité rigide.
cet enracinement peut devenir un carcan, restreignant la capacité de l’entreprise à répondre auxdéfis d’un environnement en constante évolution (Gioia et al., 2000)5. Cette communicationvise à analyser les bénéfices et les limites des racines organisationnelles en mettant en lumièrelespièges potentiels d’une identité rigide.
Les racines organisationnelles sont inscrites dans la mémoirecollectivedes salariés, c’est parelle que se perpétuentl’histoire et l’apprentissageorganisationnels (1). Cependant ces racinesne sont pas sans danger carelles peuvent devenir des freins, voire des obstacles face auxchangementsauxquels sont confrontées les organisations (2). Heureusement, il existe des pistespour éviter le piège identitaire et pour concilier racines et adaptation (3).
1 Les racines organisationnelles et la mémoire collective
Les racines d’une entreprise représentent à la fois son passé et son ancrage dans un contextesocioculturel spécifique. Elles se manifestent sous plusieurs formes, l’histoire bien sûr maisaussi la culture etparfois les mythes fondateurs.
L’histoire organisationnelle: Même si une branche de l’histoire est désormais consacrée àl’entreprise6, la plupart du temps cette histoireest non écrite et repose dans la mémoirecollective.Cette dernièreconstitue une source d’apprentissage, renforçant la cohésion interneet la fidélitéaux valeurs initiales (Hatchet Schultz, 2002)7.Ellerenvoie à l’ensemble des récits,expériences et pratiquespartagées qui forment un socle de savoirs et de valeurs transmis au fildu temps. Ces éléments sont intégrés dans les processus organisationnels, influençant lescomportementset décisions des membres. Toyota, Michelin et Airbus constituent autantd’exemplesillustrant ce concept.
Toyotaa développédèssa naissance, en 1937, le«Toyota Production System» (Lean)8. Ce système,prôné par le créateurKiichiro Toyodaestbasé sur des valeurscomme la réduction desgaspillageset l’amélioration de l’efficacité(Kaizen)9, il est devenu un pilier de l’identité del’entreprise.
Lesemployés de Toyota partagent une compréhension collective des principesLeanetKaizen grâce à des formationscontinues, des rituels comme les cercles de qualité, et des«success stories»internes.Cettemémoire collectivepermet de renforcer la cohésion interne : chaque employé se sent responsable de l’amélioration des processus, qu’il travaille sur une chaîne demontage ou dans les bureaux.
Michelina fait,depuis sa création, del’innovation un levier central d’apprentissage. Parexemple, le développement des pneus verts (qui réduisent laconsommation de carburant) apermis à l’entreprise d’intégrer lesexigences environnementales dans ses stratégiescommerciales bienavant ses concurrents. Cesexpériences pionnières ontété documentéesetpartagées en interne, formant une base de savoir pour les équipes travaillant sur des projets
5Gioia, D. A., Patvardhan, S. D., Hamilton, A. L., & Corley, K. G. (2013). «Organizational identity formation andchange». Academy ofManagement Annals, 7(1), 123–193.6Cf. la revue scientifique: «Entreprises et Histoire» crééeen 1992 parPatrick Fridenson.(Ed. ESKA)Paris7Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002).«The dynamics of organizational identity». Human Relations, 55(8), 989–1018.8Le lean managementest encore appelé «gestion au plus juste» et repose sur l’élimination des gaspillages9Le Kaisen estsouvent traduit pas amélioration continue et il met l’accent sur de petits changementsprogressifs pouraméliorerles processus
3
similaires. Les récits sur les défis techniques et commerciaux liés à ces innovations sont devenus des éléments constitutifs de la culture de l’entreprise. Ils servent à transmettre l’idée que la quête de durabilité et de performance est une tradition plutôt qu’une contrainte.
Airbus est né en 1970 d’un partenariat entre plusieurs pays européens (France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) pour concurrencer les fabricants américains. Ce contexte fondateur est profondément enraciné dans l’identité de l’entreprise. Les employés d’Airbus partagent une mémoire collective des défis liés à la collaboration multiculturelle, notamment lors des premières années où les différences nationales rendaient la coopération difficile. Au début de son histoire, Airbus a dû apprendre à naviguer dans les tensions interculturelles entre ses sites européens. Ces expériences ont été institutionnalisées dans des programmes de gestion de projet multiculturel, qui sont devenus des modèles pour d’autres entreprises globales. Par exemple, les leçons tirées de la coordination de la production de l’A380 (avec des composants construits dans plusieurs pays) ont été utilisées pour simplifier la collaboration dans les projets plus récents. Cette mémoire collective guide aujourd’hui les efforts d’Airbus pour gérer de nouveaux défis multiculturels, comme la collaboration entre sites dispersés mondialement, tout en valorisant la diversité comme un avantage compétitif.
Ces exemples montrent comment la mémoire collective peut constituer un cadre structurant pour l’apprentissage organisationnel. En conservant une trace des succès et des échecs passés, les entreprises comme Toyota, Airbus, Michelin renforcent leur cohésion interne tout en fidélisant leurs membres aux valeurs initiales. Cette mémoire n’est pas figée ; elle est réinterprétée et réactualisée pour rester pertinente dans un contexte évolutif. Les entreprises construisent des bases de données, comme des études de cas internes ou des archives de projets, pour permettre un apprentissage continu. Ces bases de connaissances ne sont pas uniquement des ressources techniques ; elles intègrent des récits sur la façon dont les équipes ont surmonté des obstacles. Des pratiques comme le debriefing après chaque projet, le rex ou retex10, ou encore l’analyse d’incidents critiques renforcent la mémoire collective. Ces pratiques transforment des événements ponctuels en savoir collectif. La mémoire collective est souvent portée par les employés expérimentés, qui servent de mentors pour transmettre les savoirs implicites et les valeurs organisationnelles.
10 Le Retour d’Expérience (appelé aussi RETEX ou REX) est une démarche visant à détecter et analyser les anomalies, les écarts et tout événement, qu’il soit positif ou négatif, en recherchant les causes et les enchaînements et en retirant des enseignements
11 Schein, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco Jossey-Bass. 1992
La culture d’entreprise : Les définitions de la culture d’entreprise sont nombreuses, celle de Schein est pour moi la plus simple : « l’ensemble des hypothèses fondamentales adoptées par un groupe » (Schein, 1992)11. Elle est un reflet des origines historiques. Les premières valeurs et croyances adoptées structurent la culture et à ce titre sont constitutives des racines. Michelin, fondée en 1889, on l’a vu, reste profondément marquée par ses valeurs d’excellence technique et d’innovation. Les comportements souhaités ou proscrits dans une entreprise découlent souvent des premières années d’existence. Les entreprises créent des symboles (logos, conventions, media interne, etc.) qui renforcent le sentiment d’appartenance et la cohésion autour de valeurs historiques.
Une culture organisationnelle forte issue des racines historiques peut aussi être un atout compétitif si elle favorise la motivation, la cohérence interne et l’engagement des employés
4
. De plus, des recherches en gestion ont prouvé que lorsque les employés partagent la culture de leur entreprise, ses valeurs et ses normes comportementales, la performance financière est au rendez-vous (Akpa, 2022)
. Dans les grandes entreprises qui se sont créées autour d’un homme ou d’une idée, se développent souvent des récits sur les origines qui retracent sous forme d’épopée les premières années, ces récits constituent également une part importante des racines.
(Thévenet, 2015)12.De plus, des recherches en gestion ont prouvé que lorsque les employéspartagent la culture de leur entreprise, ses valeurset ses normes comportementales, laperformancefinancièreest au rendez-vous (Akpa, 2022)13. Dans lesgrandesentreprises qui se sont créées autour d’un homme ou d’une idée, se développent souvent des récits sur les originesqui retracent sous forme d’épopée les premières années, ces récits constituentégalementunepart importante des racines.
Les récits(ou mythes) fondateurs: Ces récits, qui s’apparentent parfois à des mythes,offrentune légitimité interne et externe, façonnant l’image perçue par lesparties prenantes:Steve Jobsqui, tel Prométhée,rendaccessible la technologie à l’Homme encréant Apple dans ungarage,Thomas Edison quifonde GE pourapporter la lumièreà l’Humanité, etc.Anthony Galluzzos’intéresse avecLe Mythe de l’entrepreneur(2023) aux origines des mythes qui entourentcescélébrités élevées par l’opinion médiatiqueau rang de légendes:lesentrepreneursBillGates,Elon Musk,Jezz Bezos aux Etats-Unis. En France on pourrait écrire de pareilles histoiresconcernantl’opticienAlain Affelouou encoreXavier Niel: ces personnages peuplent nosimaginaires et incarnent nos conceptions de la réussite. À leurs noms sont associées les idéesd’héroïsme, de persévérance, d’inventivité ou encore de courage. C’est le récit de leurspremières années qui devient un mythe car ilest construit de tellefaçon que l’avenir del’entreprise, ses succès et selon un néologisme contemporainson «potentiel disruptif» soient contenus dans unrécit.Dans ma région,l’Occitanie,ungroupe raconteainsises origines: «Tout a commencé dansune pharmacie située place Jean-Jaurès à Castres, ville natale de Pierre Fabre. C’est ici que le jeune pharmacien, start-upper avant l’heure, met au point son premiermédicament à la fin des années 1950. Il s’agit du Cyclo 3, un veinotonique créé à partir d’un principe actifextrait desracines d’un arbrisseau local, le petit houx. Il représente un véritableprogrès thérapeutique pour l’époque…À l’image du petit houx qui reste vert et feuillu en toutesaison, legroupe PierreFabre n’acessé de se développer depuis 1962» (Source: site internet du groupe: pierre-fabre.com)
Cestroiséléments constitutifs des racines de l’entreprise,bienqu’essentiels pour créer une identité forte, peuvent également freiner l’innovation et l’adaptabilité.
2 Les pièges de l’identité enracinée
Faut-il persister dans son être contre ventset marée ou savoir s’adapterau gré deschangements? A l’évidence tout dépend de l’environnementet, engestion, la théorieditede la contingence(Lawrence et Lorsch,1967)14a démontré que si l’entreprise doitconserver unecertaine stabilité elle nedoit pas pour autant se rigidifierni passerà côté des changements deparadigmes.
Rigidité et inertie organisationnelle
Les racines profondes peuvent conduire à une réticence au changement. La pression pourpréserver les valeurs historiques peut entrer en conflit avec les impératifs d’adaptationstratégique. Par exemple, Kodak a souffert de son attachement à son identité de fabricant de
12Thévenet, M. (2015).La culture d’entreprise. Paris. Coll. Que sais-je? PUF 201513Akpa, V. O., Asikhia, O. U., &Nneji, N. E. (2021).«Organizational culture and organizational performance: Areview of literature». International Journal of Advances in Engineering and Management, 3(1), 361-372.14Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W.. Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration.Boston: Harvard Business School Press1967
5
. Le coeur de métier, les racines de Kodak relevaient de la chimie. Quand il a commencé à émerger, le numérique
n’a pas été pris au sérieux par les responsables de l’entreprise et pourtant peu de gens savent que Kodak fut bien l’inventeur de l’objet qui causera sa perte trente ans plus tard, l’appareil numérique. Kodak n’a pas « raté » la révolution numérique, mais elle a été victime du très classique dilemme de l’innovateur, décrit par le chercheur Clayton Christensen. Ce dilemme explique l’échec de l’innovation de rupture en termes de modèle d’affaire. Parfaitement au courant du développement du numérique, puisqu’elle en était l’instigateur, Kodak n’a pas voulu le promouvoir pour une raison simple : protéger son activité principale de l’époque, la vente de films argentiques. Ses racines l’ont empêché de se transformer et ont causé sa perte. De nombreuses entreprises ont ainsi disparu du fait de leur inertie, de leur rigidité et donc de leur incapacité à se réinventer : Nokia (racheté par Microsoft), Moulinex (racheté par SEB), BlackBerry (qui essaie encore de survivre dans l’internet des objets), etc.
films argentiques face à la révolution numérique (Tripsas et Gavetti, 2000)15.Le coeur de métier, les racinesde Kodak relevaient de la chimie. Quand il a commencé à émerger, le numériquen’a pas été pris au sérieux par les responsables de l’entrepriseet pourtantpeu de gens saventque Kodak fut bien l’inventeur de l’objet qui causera sa perte trente ans plus tard, l’appareilnumérique.Kodak n’a pas«raté»la révolution numérique, mais elle aété victime du trèsclassique dilemme de l’innovateur, décrit par le chercheurClayton Christensen. Ce dilemmeexplique l’échec de l’innovation de rupture en termes de modèle d’affaire.Parfaitement aucourant du développement du numérique, puisqu’elle en était l’instigateur, Kodak n’a pas voulule promouvoirpour une raison simple : protégerson activité principale de l’époque, la vente defilms argentiques. Ses racines l’ont empêché de se transformeret ontcausé sa perte. Denombreusesentreprises ont ainsi disparu du fait de leur inertie, de leur rigidité et donc de leurincapacité à se réinventer: Nokia (racheté par Microsoft), Moulinex (racheté par SEB),BlackBerry (qui essaie encore de survivre dans l’internet des objets), etc.
Souvent la disparition est moins due à la rigiditéet à l’inertiequ’à un véritable blocage, l’entreprise refusantde voir la réalité.
Exclusiondes nouveaux paradigmes
Une identité organisationnelle figée est le résultat d’un attachement excessif à des valeurs,normes et croyances perçues comme essentiellesà la survie et à la cohésion de l’organisation.Ce phénomène peut être exacerbé dans des entreprises où la culture est fortement enracinée,notamment celles opérant dans des secteurs traditionnels ou caractérisées par une longuehistoire. Bien que la stabilité identitaire puisse favoriser un sentiment d’appartenance etrenforcer la cohésion interne, elle peut égalementengendrer une résistance au changement et à la diversité des perspectives. Cette rigidité s’apparente à ce que Marchappelle« l’exploitation»au détriment de«l’exploration », réduisant ainsi la capacité d’innovation organisationnelle(voir infra).Lesentreprises ayant des culturesfortement enracinéesrisquent de marginaliserles voix divergentes, entravant ainsi la diversitécognitive nécessaireà l’innovation (Ashforthet Mael, 1989).16Les institutions bancaires traditionnelles, par exemple, ont historiquementrésisté à l’intégration detalents issus du numérique, limitant leur capacité à rivaliser avec lesFinTech dans des domaines comme la gestionautomatisée des portefeuilles ou lespaiementsinstantanés.N’ayant pucréer un écosystème favorable au développement de «néobanques» enleur sein, elles ont été contraintes (avec des succès divers) de les acheter afin de ne pas perdre leursclients qui passaient en masse du secteur traditionnel au secteurémergent.
De façon plus générale, les nouveaux paradigmesdu monde des affaires naissent rarement dansles champions d’une technologie ou d’un secteurd’activité car les champions ont plus de malque les autres à accepter unchangement desavoir ou de savoir-faire. Pour eux, avantd’apprendre il faut commencer par«désapprendre» etc’est beaucoup plus difficile. C’est pourcette raison que de nombreux champions ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes età neplus être à l’écoute de leurs parties prenantes.
15Tripsas, M., & Gavetti,G. (2000). Capabilities, cognition, and inertia: Evidencefrom digital imaging.StrategicManagement Journal, 21(10-11), 1147–1161.16Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization.Academy of ManagementReview,14(1), 20–39.
6
Risque de déconnexion avec les parties prenantes
Dans un monde où les attentes des parties prenantes évoluent rapidement, une identité trop axée sur le passé peut rendre l’entreprise déphasée par rapport aux besoins actuels de ses clients et de ses employés. Dans un livre écrit avec mon collègue S. Point nous avons relevé l’importance des « parties prenantes » dans la gestion des entreprises (Igalens et Point, 2009)17 : les parties prenantes, qu’il s’agisse des clients, des employés ou des communautés, voient leurs attentes évoluer à un rythme rapide, sous l’influence de tendances telles que la digitalisation, les préoccupations environnementales (et notamment le changement climatique) ou les revendications liées à l’inclusion sociale.
17 Igalens, J., & Point, S. Vers une nouvelle gouvernance des entreprises : l’entreprise face à ses parties prenantes. Paris. Ed Dunod. 2009
18 Gaz à effet de serre, le gaz carbonique notamment.
19 Igalens, J. Splendeurs et Misères de la RSE. Paris. Ed. EMS. 2023
20 CSRD : « Corporate Sustainability Reporting Directive », directive de l’Union Européenne N° 2022/2464
21 Principe dit de « double matérialité » ou de « double importance ».
Si l’entreprise reste focalisée sur une identité historique, elle risque de négliger ces nouveaux enjeux. Par exemple, une marque automobile insistant exclusivement sur son héritage de moteurs thermiques pourrait être perçue comme obsolète face à une clientèle et des gouvernements exigeant une transition vers des véhicules électriques. Se préoccuper de l’évolution des besoins des salariés et des clients n’est certes pas une nouveauté. Les droits des salariés sont reconnus depuis plus d’un siècle et la bible du marketing date de 1970 («Marketing Management » de Philippe Kotler) mais aujourd’hui la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) exige des dirigeants qu’ils portent une attention soutenue à des groupes sociaux qui n’ont pas forcément un lien contractuel avec l’entreprise. L’environnement avec des préoccupations liées à la biodiversité, à l’émission des GES18, au recyclage mais aussi les problématiques internationales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) telles que l’interdiction du travail des enfants, du travail forcé sont désormais inscrites à l’agenda des dirigeants. Avec l’apparition du « devoir de vigilance » (Igalens, 2023)19, l’entreprise est « étendue », c’est-à-dire qu’elle est également responsable, en matière de RSE, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs où qu’ils soient situés dans le monde. La dernière directive européenne en matière de reddition de compte20 suppose que l’entreprise définisse avec précision tous les impacts dont elle est à l’origine sur ses environnements (tant écologiques que sociaux ou sociétaux) mais également tous les impacts que les parties prenantes peuvent provoquer à son égard21.
Ces nouvelles contraintes obligent l’entreprise à demeurer en permanence à l’écoute d’une multitude de parties prenantes qui, pour chacune d’entre elles, ont leur sensibilité voire leur volatilité. Ne pas le faire c’est prendre le risque non seulement d’être déconnecté des environnements pertinents mais c’est aussi celui d’être irresponsable socialement. Or, de ce point de vue, un enracinement historiquement, géographiquement, culturellement daté n’est pas de nature à favoriser le cosmopolitisme porté par la diversité des parties prenantes.
Encadré : Toys “R” Us : Un attachement excessif aux racines traditionnelles
7
Toys “R” Us est un cas emblématique d’une entreprise figé et immobilisé par ses racines au détriment de l’innovation et de l’adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. Toys “R” Us s’est longtemps appuyé sur son modèle historique de grands magasins spécialisés, où les clients pouvaient explorer des rayons remplis de jouets. Ce modèle, fondé sur l’expérience physique et un vaste choix de produits, était au coeur de l’identité de l’entreprise. Les magasins étaient conçus pour offrir une expérience immersive, un « paradis des jouets » pour les enfants et leurs parents. On n’est pas loin du monde décrit dans « Au Bonheur des dames » (Zola, 2022. Edition originale :1883)22 mais le prêt-à-porter féminin est ici remplacé par le jouet. Avec l’essor du commerce en ligne dans les années 2000, Toys “R” Us a tardé à investir dans le numérique, restant focalisé sur ses magasins physiques. Cette fixation sur un modèle traditionnel a empêché l’entreprise de concurrencer efficacement des acteurs comme Amazon, qui proposaient une offre de jouets tout aussi variée, mais accessible en ligne avec une logistique rapide.
22 Zola, É. Au bonheur des dames: les Rougon-Macquart (Vol. 8). Paris. Les beaux books. 2002 mais l’édition originale date de 1883
L’attachement à ses racines a également conduit Toys “R” Us à sous-estimer les évolutions des comportements d’achat. Les consommateurs modernes privilégient la commodité, des prix compétitifs et des services rapides, des éléments que les plateformes numériques maîtrisaient mieux. Enfin, Toys “R” Us a continué à percevoir ses magasins comme des lieux incontournables pour acheter des jouets, sans reconnaître que la demande évoluait vers des achats en ligne et des expériences « omnicanales » (combinaison de magasins physiques et en ligne).
Ironiquement, Toys “R” Us a tenté de compenser son retard numérique en signant un partenariat exclusif avec Amazon au début des années 2000. L’objectif était de déléguer la gestion de son e-commerce à Amazon tout en maintenant son identité et en s’accrochant à ses racines symbolisées par les magasins physiques. Ce partenariat s’est retourné contre Toys “R” Us lorsque Amazon a commencé à vendre des jouets d’autres marques, concurrençant directement Toys “R” Us. L’entreprise a perdu à la fois le contrôle de son canal en ligne et l’opportunité de développer sa propre plateforme e-commerce, accentuant son retard. L’entreprise a persisté à considérer ses magasins physiques comme immuables, refusant de les adapter ou de les intégrer à une stratégie omnicanale.
En 2017, Toys “R” Us a fait faillite, incapable de concurrencer les nouveaux acteurs du marché. La dette importante accumulée par la gestion de ses magasins physiques, combinée à son incapacité à s’adapter à l’essor du commerce en ligne, a scellé son sort.
L’échec de Toys “R” Us illustre les risques d’un attachement excessif aux racines organisationnelles lorsque :
• L’entreprise refuse de remettre en question un modèle historique, même face à des évolutions structurelles du marché.
• Les valeurs et pratiques traditionnelles sont perçues comme immuables, empêchant une adaptation proactive.
• Les nouvelles attentes des parties prenantes, comme les consommateurs exigeant plus de commodité et de digitalisation, sont ignorées.
8
3 Stratégies pour éviter les pièges identitaires
L’entreprise est-elle condamnée à naviguer entre le Charybde des racines et de l’identité et le Scylla de l’adaptabilité voire de l’impersonnalité ? Comment conserver ses racines sans passer à côté de l’évolution des marchés, de l’innovation technologique ou tout simplement de l’air du temps ? Trois pistes s’offrent à l’entreprise, recontextualiser en permanence ses racines, encourager l’apprentissage et favoriser le dialogue avec ses parties prenantes.
Recontextualiser les racines
Les entreprises peuvent revisiter leurs racines en les adaptant aux enjeux contemporains. Cela implique de conserver l’essence des valeurs fondatrices tout en les traduisant dans des pratiques modernes (Gioia et al., 2013)23. Revisiter les racines signifie retourner à l’essence des valeurs qui définissent l’organisation, telles que l’intégrité, la qualité, ou l’innovation, pour les adapter au contexte contemporain. Cela ne consiste pas à abandonner ces valeurs, mais à en actualiser l’expression. Par exemple, une entreprise dont la mission originelle est “d’améliorer la vie des gens” pourrait historiquement s’être concentrée sur des produits physiques. Dans un contexte contemporain marqué par la transformation numérique et les préoccupations environnementales, cette mission pourrait être réinterprétée pour inclure des solutions digitales ou des produits écoresponsables. Un exemple emblématique est celui de Patagonia, une entreprise américaine spécialisée dans les vêtements de plein air. Depuis sa création, Patagonia s’est positionnée autour de valeurs fortes, notamment la protection de l’environnement. Ces valeurs fondatrices restent au coeur de son identité, mais l’entreprise a su les traduire dans des pratiques modernes en réponse aux défis actuels liés au changement climatique et à la surconsommation. Patagonia vient de lancer un programme nommé “Worn Wear”, qui encourage les clients à réparer ou acheter des vêtements de seconde main plutôt que d’acquérir du neuf ce qui est assez novateur dans un secteur qui a plutôt tendance à créer des modes éphémères.
23 Gioia, D. A., Schultz, M., & Corley, K. G. (2000). Organizational identity, image, and adaptive instability. Academy of Management Review, 25(1), 63–81.
24 March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71–87.
25 le Fab Lab est un atelier dédié à l’innovation et au prototypage rapide. Le principe des Fab Labs est le partage libre d’espaces, de machines, de compétences et de savoirs.
Encourager l’apprentissage organisationnel
March (1991)24 distingue deux types de processus organisationnels l’exploitation et l’exploration.
L’exploitation des acquis passe par l’optimisation des ressources existantes, l’amélioration des processus et la capitalisation sur les savoirs historiques. L’exploration de nouveaux territoires s’appuie sur l’expérimentation, la recherche d’innovations et le développement de nouvelles compétences.
Les organisations dites « ambidextres » réussissent à concilier ces deux dimensions. Elles sont capables d’exploiter les connaissances existantes tout en explorant des opportunités émergentes, grâce à une structuration adaptée et une culture d’apprentissage dynamique. Le Fab Lab25
9
d’entreprise, en ouvrant les activités exploratoires aux membres des unités d’exploitation, soulève ce défi intéressant : celui de la conciliation entre activités d’exploitation et activités d’exploration au niveau des salariés. Le constructeur automobile français Renault a été un pionnier de cette démarche dès 2011.
Favoriser un dialogue continu avec les parties prenantes
Une identité dynamique se nourrit des interactions avec les parties prenantes. La co-construction de l’identité organisationnelle peut aider à maintenir sa pertinence tout en intégrant les évolutions sociétales et technologiques (Schultz et Hernes, 2013)26. La co-construction fait référence à un processus collaboratif où les parties prenantes participent activement à définir et redéfinir les éléments fondamentaux de l’identité organisationnelle. Ce processus s’appuie sur la reconnaissance des parties prenantes comme partenaires stratégiques. Leur implication dans les réflexions et les décisions stratégiques apporte une richesse de perspectives et renforce la légitimité de l’organisation. Par exemple, dans les entreprises de service, les employés peuvent contribuer à l’expression des valeurs organisationnelles par leurs comportements et leurs initiatives. De leur côté, les clients, en formulant leurs attentes ou leurs critiques, influencent la perception de l’organisation et son positionnement stratégique. Ce processus itératif s’apparente à une boucle de rétroaction dans laquelle l’organisation apprend, s’adapte et se transforme continuellement.
26 Schultz, M., & Hernes, T. (2013). A temporal perspective on organizational identity. Organization Science, 24(1), 1–21.
Conclusion : des racines et des ailes
L’identité organisationnelle, bien qu’enracinée dans l’histoire, doit rester fluide pour répondre aux exigences d’un environnement complexe et dynamique. Les racines ne doivent pas être perçues comme des chaînes, mais comme des ressources adaptables. Les recherches actuelles se concentrent sur les mécanismes spécifiques permettant aux entreprises de maintenir cet équilibre entre enracinement et adaptation, en étudiant des cas concrets d’entreprises ayant réussi ou échoué dans cet exercice. Il faut arriver à concilier des racines et des ailes. Dans l’industrie du luxe, notamment du parfum, de la mode, de la joaillerie, cet équilibre est particulièrement recherché : les « maisons »mettent en avant leurs racines pour mieux présenter leurs nouveautés.