Les récentes décisions de l’administration Trump ont mis à mal des pans entiers de la recherche scientifique aux États-Unis, en particulier les domaines liés au climat et aux sciences sociales. La réduction drastique des budgets de la NOAA, la mise à l’écart de scientifiques des instances de concertation internationale comme le GIEC ou encore l’arrêt de programmes essentiels en climatologie témoignent d’une volonté de politiser et de contrôler la science .
Face à ce climat hostile, de nombreux chercheurs ont perdu leur emploi ou leur financement et se voient contraints de chercher refuge ailleurs. L’Europe, fidèle à ses traditions humanistes et universalistes, s’affirme aujourd’hui comme un espace de liberté et de refuge pour ces chercheurs. Cet accueil est bien plus qu’un geste d’hospitalité académique : il s’agit d’une affirmation de valeurs fondamentales qui placent la liberté de penser, la rationalité et l’esprit critique au cœur du projet scientifique et démocratique. Plusieurs universités et organismes de recherche européens, notamment en France, en Allemagne et en Espagne, ont lancé des programmes spécifiques pour intégrer ces scientifiques.
L’université d’Aix-Marseille, par exemple, a inauguré le programme « Safe Place for Science », qui a déjà reçu des dizaines de candidatures, en particulier de climatologues et de spécialistes des sciences sociale et qui aujourd’hui accueille ses premiers chercheurs, notamment l’historien Brian Sandberg spécialiste de la violence religieuse. Cet afflux de chercheurs exilés ne se limite pas à une dynamique académique. Il révèle une recomposition plus profonde du soft power scientifique mondial. Comme l’a défini Nye, le soft power repose sur la capacité d’un acteur à exercer une influence non par la contrainte, mais par l’attraction et la diffusion de valeurs. En accueillant ces chercheurs, l’Europe envoie un message fort : la connaissance n’appartient à aucun pouvoir politique et la recherche scientifique doit demeurer libre. Cette posture accroît le rayonnement intellectuel et diplomatique de l’Union européenne, en particulier dans des domaines cruciaux comme le climat, les transitions énergétiques et les sciences humaines. Dans un contexte de compétition internationale pour le leadership scientifique, l’Europe se positionne comme un sanctuaire pour la pensée critique, renforçant son identité comme pôle mondial d’excellence.
Au sein de @IAS (Institut International de l’AUDIT Social) ces questions nous intéressent et nous pensons qu’en s’érigeant en protectrice de la science indépendante, l’Europe renoue avec l’héritage des Lumières et de la rationalité critique et que l’intégration de ces chercheurs crée des passerelles entre les deux continents et pourrait permettre une nouvelle diplomatie scientifique capable de dépasser les clivages politiques. Qu’en pensez-vous ?

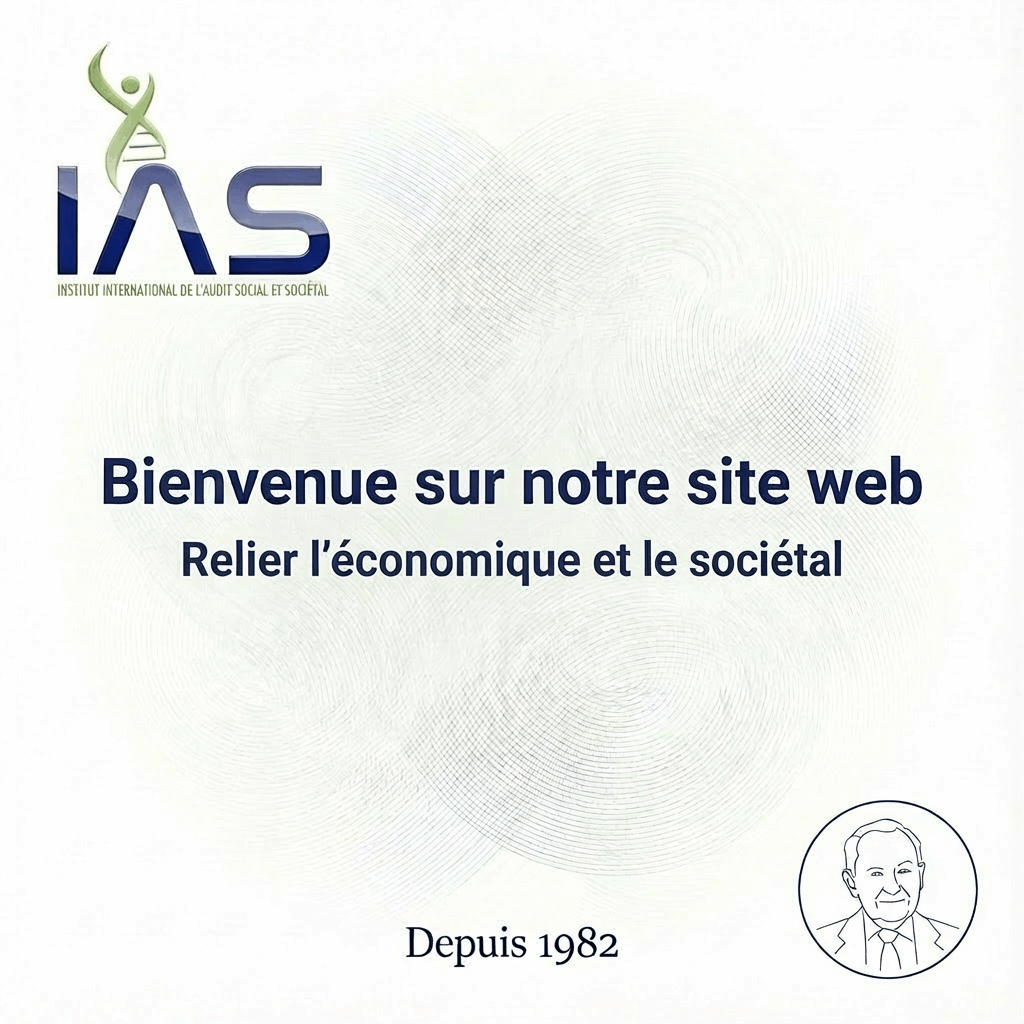

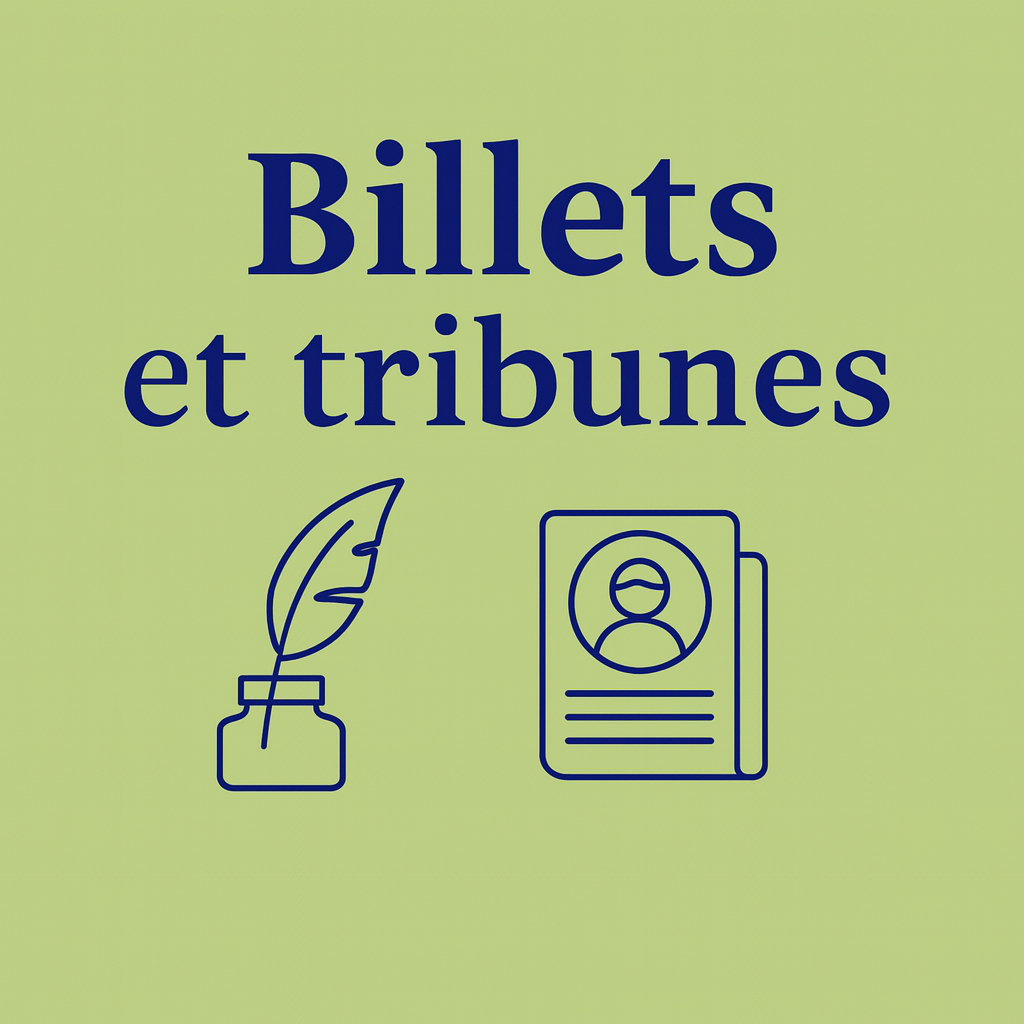
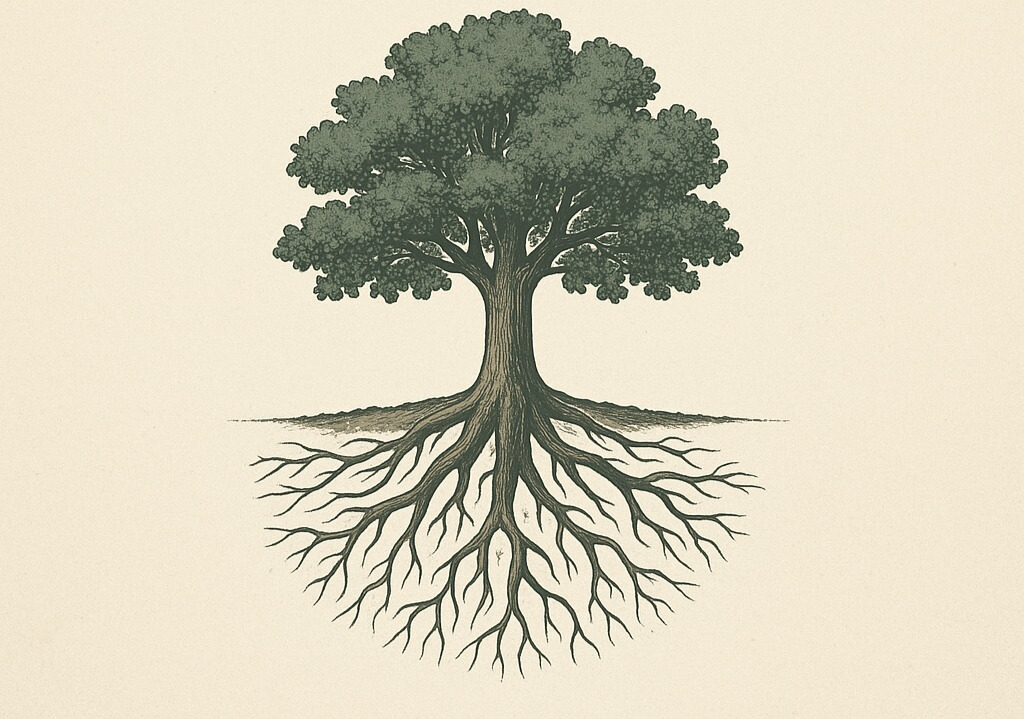


Oui, une réflexion qui mérite toute notre attention avec des points que nous aborderons lors de notre université de printemps à Genève les 7 et 8 mai 2026.
Merci du retour